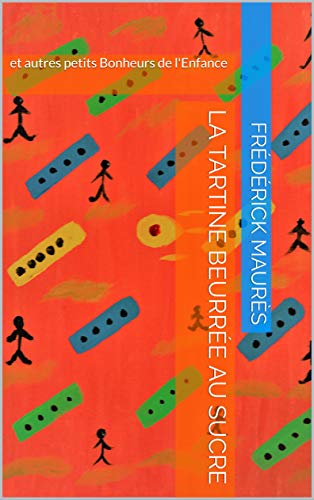
Douces ou sucrées, amères ou rances, parfois empoisonnées, nos « madeleines » ont un goût qui se rappelle régulièrement à nous. Il suffit d’un rien, une insignifiance du quotidien ou une vague perception de nos sens, pour que, sans prévenir, elles reviennent peupler notre mémoire, prendre de nouveau vie dans notre actualité et nous rappeler, même partiellement, pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes. Elles peuvent faire sourire ou faire resurgir de mauvais souvenirs, elles ont toutes en commun d’avoir contribué à nous façonner.
À travers une succession de récits et de souvenirs d’enfance, l’auteur nous entraîne dans la douce nostalgie d’un temps qui n’est plus, mais qui lui demeure immanent. Cette "Tartine beurrée au sucre et autres petits Bonheurs de l’Enfance", au goût tantôt acidulé, tantôt suave, se déguste par petits bouts, avec gourmandise, pour nous plonger dans un univers de tendresse qui ressemble étrangement au bonheur.
À travers une succession de récits et de souvenirs d’enfance, l’auteur nous entraîne dans la douce nostalgie d’un temps qui n’est plus, mais qui lui demeure immanent. Cette "Tartine beurrée au sucre et autres petits Bonheurs de l’Enfance", au goût tantôt acidulé, tantôt suave, se déguste par petits bouts, avec gourmandise, pour nous plonger dans un univers de tendresse qui ressemble étrangement au bonheur.
Extrait
Le bidon à lait
Le bidon à lait
C’était à la fin des années soixante. J’avais alors à peine dix ans. Non loin de la maison de campagne que les amis de mes grands-parents maternels mettaient tous les étés à notre disposition pendant qu’ils séjournaient au Chili, il y avait une petite ferme qui ne payait pas de mine mais que j’adorais. Nous nous y rendions une à deux fois par semaine, à l’occasion d’une promenade semi-nocturne, sur le coup des vingt-et-une heures trente. Nous partions au moment où le jour faiblit et où la fraîcheur du soir apporte un peu de réconfort après les records de chaleur subis dans la journée. Ma grand-mère me confiait le bidon à lait en aluminium que je portais à l’aller comme au retour. J’avais à chaque fois l’impression de partir à l’aventure, une aventure extraordinaire, dans la pénombre d’une petite route de campagne sur laquelle ne passaient que quelques rares tracteurs.
Vers la fin du mois d’août, les jours raccourcissant, mon grand-père emmenait une torche électrique qu’il me donnait dès que la nuit commençait à tomber. Promu guide de la petite troupe, je prenais alors mon rôle très à cœur, mettant en garde, plus que de raison, contre les aspérités réelles ou imaginées d’un macadam grossièrement goudronné, irrégulier et mal lissé. Je demeurais fasciné par la nuée désordonnée d’insectes et de moustiques qui s’agitaient, affolés, en croisant le faisceau intrusif de ma torche.
À perte de vue, des champs de blé, de maïs, de tournesol et de foin formaient un paysage sans fin, symbole de la fertilité d’une terre que, en ma qualité de citadin, je n’avais guère l’occasion d’observer le reste de l’année. Seuls quelques bosquets, disséminés ça et là, venaient rompre l’apparente monotonie de ces étendues cultivées. Le bruissement des peupliers, la majesté des vieux chênes pédonculés ou la démesure des figuiers aux pousses désordonnées créaient une impression de diversité qui réjouissait les sens. J’imaginais que, derrière l’un de ces arbres, ou tapi à l’ombre d’un buisson, se cachait une bête sauvage qui nous observait en silence. Fort heureusement, la lumière jaune vif que je balayais largement devant moi permettrait de tenir l’animal féroce à bonne distance. De temps à autre, le hululement d’une chouette ou une envolée lointaine de chauves-souris venaient ajouter un peu de piment à l’aventure. Retenant alors mon souffle et chuchotant de façon parfaitement intelligible un « Stop ! » qui ne laissait place à aucune discussion, je m’arrêtais net, restais figé de longues secondes, la main tendue en arrière pour intimer l’ordre de cesser toute marche en avant. Je tapais avec la torche un ou deux coups sur le bidon métallique afin d’annihiler toute velléité d’agression. Puis, le danger écarté, je reprenais en héros ma course vers l’inconnu, après avoir fait signe aux grands qu’ils étaient de nouveau autorisés à avancer. De guide officiel, je devenais ainsi éclaireur et protecteur des adultes, lesquels se prêtaient bien volontiers au jeu.
Sur la plus grande partie de ce trajet, que je me plaisais à transformer en parcours semé d’embûches, tout respirait le calme. Un calme puissant, qui vous poussait à la communion avec la nature, dans une sorte d’imprégnation permanente du corps et de l’esprit par des choses vivantes, simples, inhérentes. Seuls nos pas de promeneurs, une sandale qui racle le sol, un talon qui broie un petit monticule de cailloux minuscules, venaient parfois troubler le caractère paisible de l’instant. J’avais ce sentiment étrange que le monde nous appartenait et que personne d’autre ne l’habitait.
Ce n’est qu’au bout d’une petite trentaine de minutes que nous parvenions, au détour d’un chemin, à la petite ferme simple et rustique où vivait un couple de paysans âgés, aux visages marqués par la rudesse des travaux agricoles. Les brûlures du soleil avaient crevassé leur peau qui tirait sur le brun foncé. De nombreuses ridules cerclaient leurs yeux noirs jusque sous leurs épais sourcils broussailleux. Ils étaient tous deux accueillants, chaleureux et inspiraient spontanément la sympathie, avec toujours un petit mot gentil à mon égard. Je ne comprenais pas tout ce qu’ils disaient, loin s’en faut, mais mon grand-père paraissait maîtriser parfaitement le patois bordelais, cette langue étrange que je ne l’avais entendu pratiquer qu’en de très rares occasions. Cette compétence linguistique me rassurait, car tout empêchement de communication m’aurait fortement contrarié, tant je tenais à ce que cette relation privilégiée perdure dans une parfaite harmonie. Les fermiers roulaient fortement les « r », parlaient d’une voix grave et gutturale. Ils ponctuaient parfois leurs propos d’une esquisse de sourire, un sourire réservé, presque timide, qui avait l’air de s’excuser. Un sourire que j’aimais beaucoup, car je le percevais comme profond et plus sincère que bien des éclats de rire. Dans leur langage, ça voulait dire : « Nous nous sommes compris et nous partageons les mêmes valeurs. Vous serez toujours les bienvenus chez nous ».
Nous ne connaissions pas leurs prénoms, encore moins leurs noms. Nous les avions surnommés « les fermiers ». Nous n’avions pas besoin d’en savoir davantage : l’expression de leur visage valait toutes les identités. Ils vivaient seuls, dans une pièce unique, fraîche même par fortes chaleurs, qui leur servait à la fois de chambre, de cuisine et de salle à manger. Par la fenêtre, au pourtour de bois gris tout écaillé, on percevait la vie en provenance de la basse-cour attenante, le martèlement des sabots des deux vaches sur le sol en terre battue de l’étable, le ballottement métallique du seau accroché au-dessus du puits. Une myriade d’odeurs puissantes se mélangeait pour former un bouquet caractéristique des lieux, un bouquet que j’aurais pu identifier les yeux fermés. Dans ce cocktail si singulier, je reconnaissais l’odeur acre de la terre sèche de la courette, les effluves d’une récente lessive à la main au savon de Marseille, la senteur poussiéreuse et acidulée du jambon déjà bien entamé, pendu à la poutre et emmitouflé dans un épais torchon blanc, les arômes entêtants des pâtées de maïs, de lait et de pain qui régalaient déjà le poulailler. Une énorme boule de campagne trônait au milieu de l’épaisse table en chêne vermoulu. Trois tranches avaient été préparées à notre attention. Nous les mangions sur le chemin du retour en nous extasiant sur le parfum frais et enivrant de la mie moelleuse à souhait, sur le craquant rude et viril de la croûte cuite juste comme il faut.
Suivant un rituel bien établi, je tendais fièrement mon bidon au fermier. Après tout, c’était moi l’aventurier triomphant ! Il me gratifiait d’un large sourire, laissant entrevoir une dentition chaotique qui achevait de me convaincre un peu plus à chaque fois de la nécessité de me brosser les dents matin et soir. Quelques minutes plus tard, il revenait avec le bidon rempli de lait chaud, fraichement trait. Je saisissais le précieux trésor à deux mains et le serrais contre ma poitrine pour plus de sécurité. Nous prenions alors congé. Je n’aimais pas le lait cru, mais le bidon lourd avait pour moi une double valeur : celle de la responsabilité qui m’était donnée de le ramener à bon port et celle de l’importance que son contenu représentait aux yeux de mes grands-parents.
En serrant bien fort dans ma petite main la poignée de bois de l’anse, j’inversais les rôles et devenais à mon tour l’aventurier valeureux et victorieux qui ramène la becquée au nid.
Vers la fin du mois d’août, les jours raccourcissant, mon grand-père emmenait une torche électrique qu’il me donnait dès que la nuit commençait à tomber. Promu guide de la petite troupe, je prenais alors mon rôle très à cœur, mettant en garde, plus que de raison, contre les aspérités réelles ou imaginées d’un macadam grossièrement goudronné, irrégulier et mal lissé. Je demeurais fasciné par la nuée désordonnée d’insectes et de moustiques qui s’agitaient, affolés, en croisant le faisceau intrusif de ma torche.
À perte de vue, des champs de blé, de maïs, de tournesol et de foin formaient un paysage sans fin, symbole de la fertilité d’une terre que, en ma qualité de citadin, je n’avais guère l’occasion d’observer le reste de l’année. Seuls quelques bosquets, disséminés ça et là, venaient rompre l’apparente monotonie de ces étendues cultivées. Le bruissement des peupliers, la majesté des vieux chênes pédonculés ou la démesure des figuiers aux pousses désordonnées créaient une impression de diversité qui réjouissait les sens. J’imaginais que, derrière l’un de ces arbres, ou tapi à l’ombre d’un buisson, se cachait une bête sauvage qui nous observait en silence. Fort heureusement, la lumière jaune vif que je balayais largement devant moi permettrait de tenir l’animal féroce à bonne distance. De temps à autre, le hululement d’une chouette ou une envolée lointaine de chauves-souris venaient ajouter un peu de piment à l’aventure. Retenant alors mon souffle et chuchotant de façon parfaitement intelligible un « Stop ! » qui ne laissait place à aucune discussion, je m’arrêtais net, restais figé de longues secondes, la main tendue en arrière pour intimer l’ordre de cesser toute marche en avant. Je tapais avec la torche un ou deux coups sur le bidon métallique afin d’annihiler toute velléité d’agression. Puis, le danger écarté, je reprenais en héros ma course vers l’inconnu, après avoir fait signe aux grands qu’ils étaient de nouveau autorisés à avancer. De guide officiel, je devenais ainsi éclaireur et protecteur des adultes, lesquels se prêtaient bien volontiers au jeu.
Sur la plus grande partie de ce trajet, que je me plaisais à transformer en parcours semé d’embûches, tout respirait le calme. Un calme puissant, qui vous poussait à la communion avec la nature, dans une sorte d’imprégnation permanente du corps et de l’esprit par des choses vivantes, simples, inhérentes. Seuls nos pas de promeneurs, une sandale qui racle le sol, un talon qui broie un petit monticule de cailloux minuscules, venaient parfois troubler le caractère paisible de l’instant. J’avais ce sentiment étrange que le monde nous appartenait et que personne d’autre ne l’habitait.
Ce n’est qu’au bout d’une petite trentaine de minutes que nous parvenions, au détour d’un chemin, à la petite ferme simple et rustique où vivait un couple de paysans âgés, aux visages marqués par la rudesse des travaux agricoles. Les brûlures du soleil avaient crevassé leur peau qui tirait sur le brun foncé. De nombreuses ridules cerclaient leurs yeux noirs jusque sous leurs épais sourcils broussailleux. Ils étaient tous deux accueillants, chaleureux et inspiraient spontanément la sympathie, avec toujours un petit mot gentil à mon égard. Je ne comprenais pas tout ce qu’ils disaient, loin s’en faut, mais mon grand-père paraissait maîtriser parfaitement le patois bordelais, cette langue étrange que je ne l’avais entendu pratiquer qu’en de très rares occasions. Cette compétence linguistique me rassurait, car tout empêchement de communication m’aurait fortement contrarié, tant je tenais à ce que cette relation privilégiée perdure dans une parfaite harmonie. Les fermiers roulaient fortement les « r », parlaient d’une voix grave et gutturale. Ils ponctuaient parfois leurs propos d’une esquisse de sourire, un sourire réservé, presque timide, qui avait l’air de s’excuser. Un sourire que j’aimais beaucoup, car je le percevais comme profond et plus sincère que bien des éclats de rire. Dans leur langage, ça voulait dire : « Nous nous sommes compris et nous partageons les mêmes valeurs. Vous serez toujours les bienvenus chez nous ».
Nous ne connaissions pas leurs prénoms, encore moins leurs noms. Nous les avions surnommés « les fermiers ». Nous n’avions pas besoin d’en savoir davantage : l’expression de leur visage valait toutes les identités. Ils vivaient seuls, dans une pièce unique, fraîche même par fortes chaleurs, qui leur servait à la fois de chambre, de cuisine et de salle à manger. Par la fenêtre, au pourtour de bois gris tout écaillé, on percevait la vie en provenance de la basse-cour attenante, le martèlement des sabots des deux vaches sur le sol en terre battue de l’étable, le ballottement métallique du seau accroché au-dessus du puits. Une myriade d’odeurs puissantes se mélangeait pour former un bouquet caractéristique des lieux, un bouquet que j’aurais pu identifier les yeux fermés. Dans ce cocktail si singulier, je reconnaissais l’odeur acre de la terre sèche de la courette, les effluves d’une récente lessive à la main au savon de Marseille, la senteur poussiéreuse et acidulée du jambon déjà bien entamé, pendu à la poutre et emmitouflé dans un épais torchon blanc, les arômes entêtants des pâtées de maïs, de lait et de pain qui régalaient déjà le poulailler. Une énorme boule de campagne trônait au milieu de l’épaisse table en chêne vermoulu. Trois tranches avaient été préparées à notre attention. Nous les mangions sur le chemin du retour en nous extasiant sur le parfum frais et enivrant de la mie moelleuse à souhait, sur le craquant rude et viril de la croûte cuite juste comme il faut.
Suivant un rituel bien établi, je tendais fièrement mon bidon au fermier. Après tout, c’était moi l’aventurier triomphant ! Il me gratifiait d’un large sourire, laissant entrevoir une dentition chaotique qui achevait de me convaincre un peu plus à chaque fois de la nécessité de me brosser les dents matin et soir. Quelques minutes plus tard, il revenait avec le bidon rempli de lait chaud, fraichement trait. Je saisissais le précieux trésor à deux mains et le serrais contre ma poitrine pour plus de sécurité. Nous prenions alors congé. Je n’aimais pas le lait cru, mais le bidon lourd avait pour moi une double valeur : celle de la responsabilité qui m’était donnée de le ramener à bon port et celle de l’importance que son contenu représentait aux yeux de mes grands-parents.
En serrant bien fort dans ma petite main la poignée de bois de l’anse, j’inversais les rôles et devenais à mon tour l’aventurier valeureux et victorieux qui ramène la becquée au nid.
